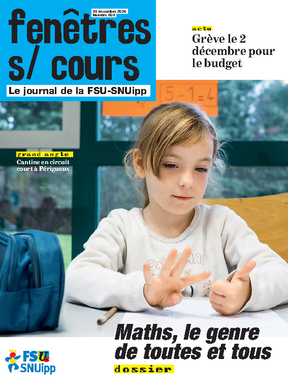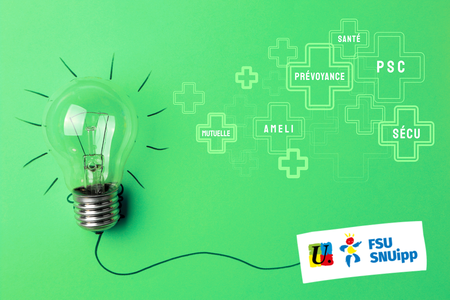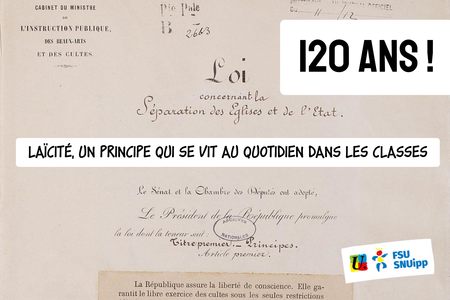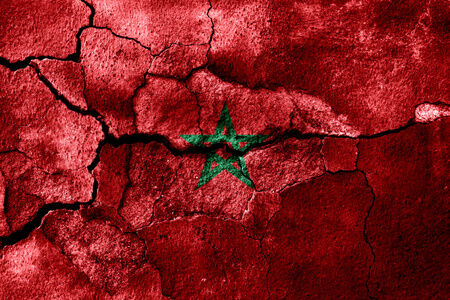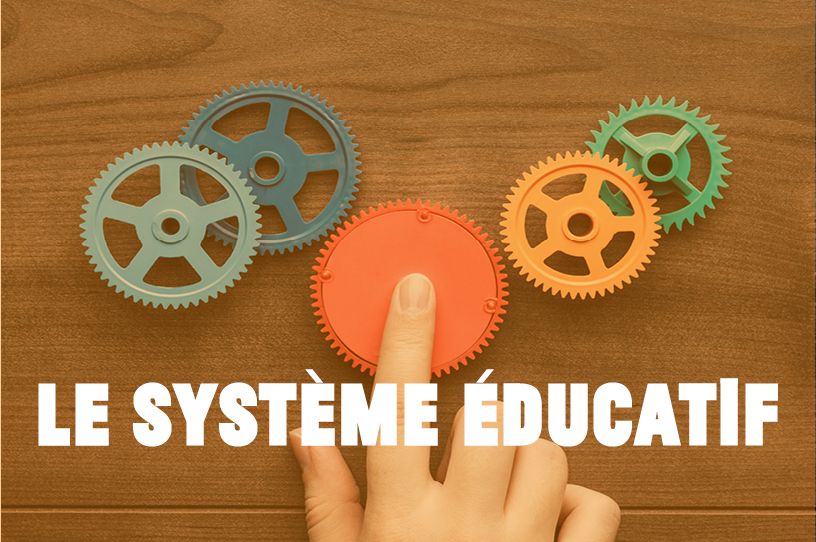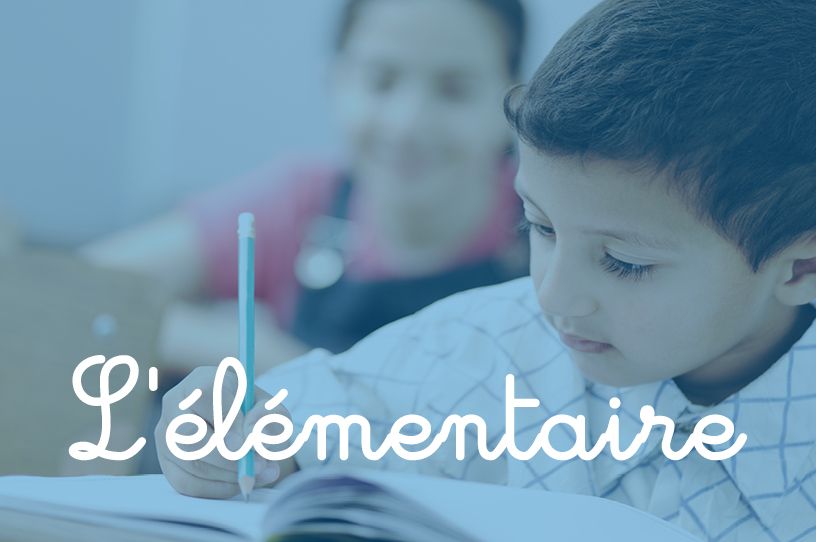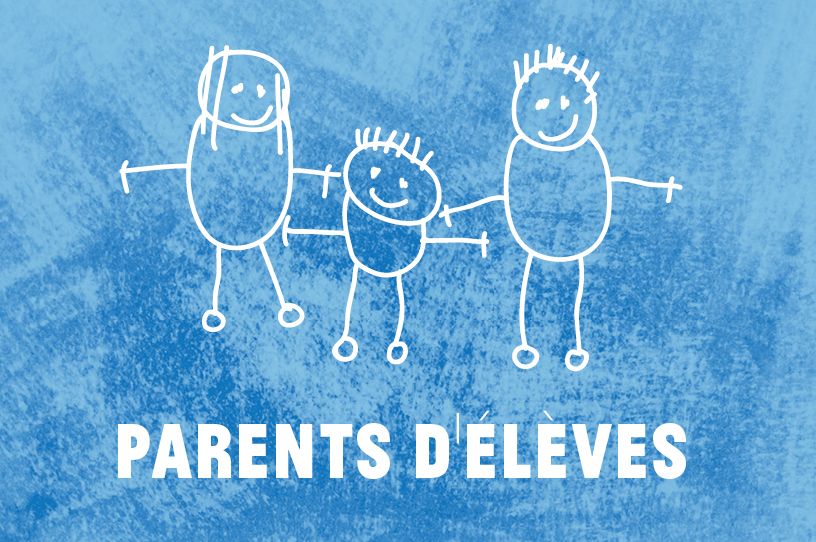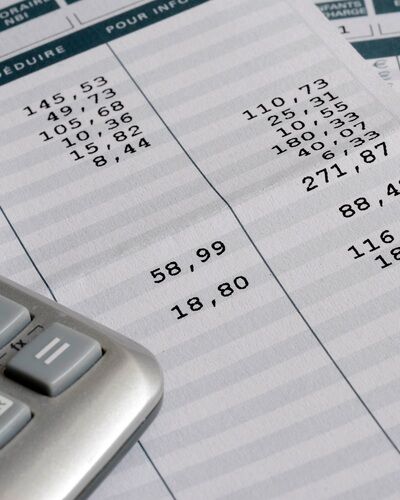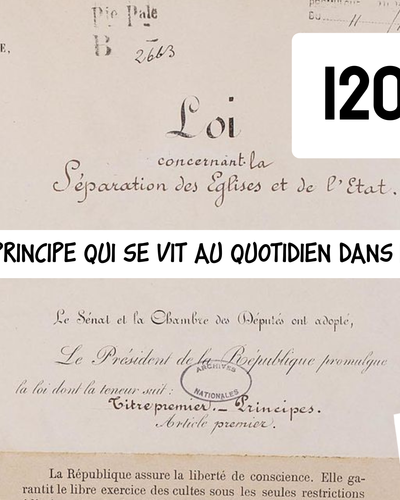Géographie, une nouvelle aire
Mis à jour le 25.11.22
min de lecture
Nous sommes tous des êtres géographes : une discipline fondamentale qui donne les clés de compréhension de l'urgence écologique. Lien entre espace vécu et espace pensé. Comment enseigner la géographie sans être géographe ?
Sylvie Joublot-Ferré est docteure en géographie (ENS Lyon), professeur agrégée et diplômée de sciences politiques, chargée d'enseignement à la Haute Ecole pédagogique de Lausanne

La géographie : une discipline fondamentale ?
Dans les systèmes éducatifs francophones, la géographie est une discipline traditionnellement enseignée tout au long de la scolarité obligatoire. Mais surtout, nous sommes tous des êtres géographiques avec des pratiques spatiales quotidiennes tout au long de la vie. Il est donc fondamental d’aider les individus à mieux maitriser le rapport à l’espace, à mieux comprendre les enjeux à propos de l’espace. La spatialité fait partie intégrante de la condition humaine. Les enjeux écologiques spécifiques à notre époque anthropocène, les menaces multiples sur notre cadre de vie, les limites des ressources planétaires dépassent la stricte condition géographique jusqu’à atteindre une dimension ontologique qui rendent plus indispensables encore l’enseignement de la géographie, la nécessité d’entretenir le goût de la terre avec les enfants. La géographie a un message, des modes de pensée, des raisonnements, des éclairages, des regards pour mieux comprendre notre place sur la terre. Il y a enfin un enjeu important de culture commune car la terre est un espace fini et partagé, ce qu’a tendance à faire oublier le pavage administratif et nationaliste.
En quoi donne-t-elle des clés de compréhension de l'urgence écologique ?
Dans un premier temps, elle peut donner des clés de compréhension de son espace de vie quotidien. Elle permet de mieux lire, comprendre et prendre conscience de l’attachement au lieu de vie et de susciter l’expérience commune de l’espace, ce qui est très important avec de jeunes enfants. Comment habite-t-on son lieu de vie au quotidien ? Ensuite, à partir de représentations spatiales ou d’une enquête de terrain, on peut s’engager dans une perspective plus prospective. Comment imaginer l’espace autrement ? Qu’aime- rait-on y ajouter ? Dans l’espace urbain, interroger la place du vivant, des espaces verts, du bien-être humain peut conduire du diagnostic spatial de « où on vit » à la prospective spatiale vers des pistes d’amélioration, pas forcément réalistes mais qui déclenchent la réflexion.
Quel lien entre espace vécu et espace pensé ?
Pour le comprendre, il faut entrer dans une réflexivité qui peut être provoquée par l’expérience spatiale directe, collective, par le fait de réfléchir à nos modes d’habiter localement, à la cohabitation avec les autres êtres vivants. Il y a plusieurs entrées pour comprendre que le cadre de vie n’est pas donné mais qu’il évolue, sous l’impact de l’humanité, devenue désormais force géologique. Pourquoi j’aime ce lieu, je m’y sens bien et j’ai envie de le préserver ? Sachant qu’il s’agit d’une expérience sociale, cela ne se fait pas sans les autres. La sociabilité qualifie le rapport au lieu. La classe constitue donc un atout pour y réfléchir en commun. De ce point de vue, les sorties scolaires, expériences directes avec l’espace et les autres, sont importantes pour conceptualiser ce lien.
Comment enseigner la géographie sans être géographe ?
Nous sommes tous un peu géographes, même s’il existe un corpus conceptuel qu’il est préférable de maitriser. En primaire, il est possible de mettre l’accent sur les liens entre les disciplines. Dans l’espace urbain proche, l’étude géographique d’un parc s’enrichit des sciences de la nature et de l’étude des saisons, de l’histoire, de la littérature, des mathématiques… Sans qu’il soit indispensable de s’engager dans une pédagogie de projet, on peut aborder une thématique de manière interdisciplinaire. La géographie de terrain peut s’appuyer sur une démarche d’enquête. À partir d’un questionnement, prospecter pour récolter des données et vérifier. Avec les jeunes enfants, cela peut prendre la forme de la description et de ses opérations inhérentes : caractériser, nommer, catégoriser... Pour tenir un carnet de bord, on peut prendre des photos, interviewer des passants, enregistrer des sons… s’engager dans une démarche polysensorielle pour appréhender l’espace à travers la vue, l’ouïe mais aussi le toucher auquel les enfants sont sensibles. Au retour en classe, le travail réflexif s’engage à partir des données collectées, qui peut conduire à un nouveau récit partagé. On peut également convoquer les représentations des élèves à partir de cartes mentales ou de schémas heuristiques comme éléments déclencheurs de l’enquête.