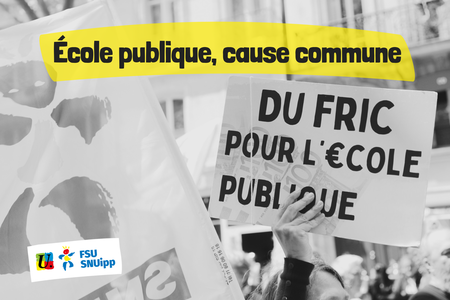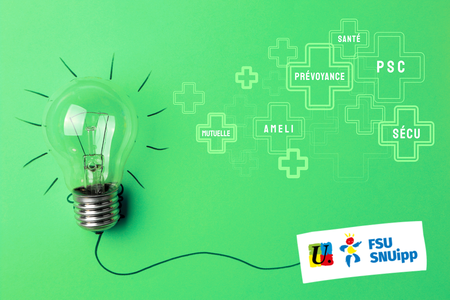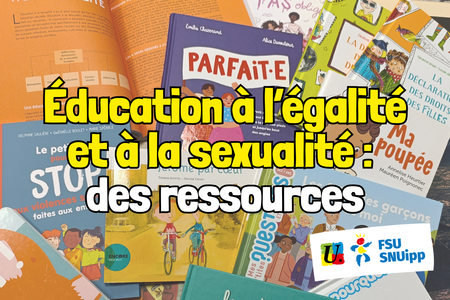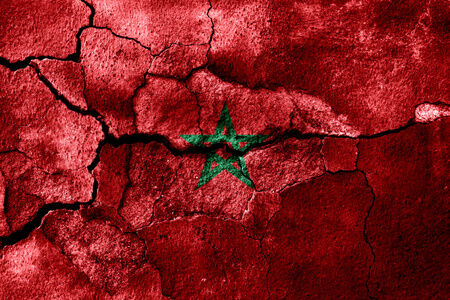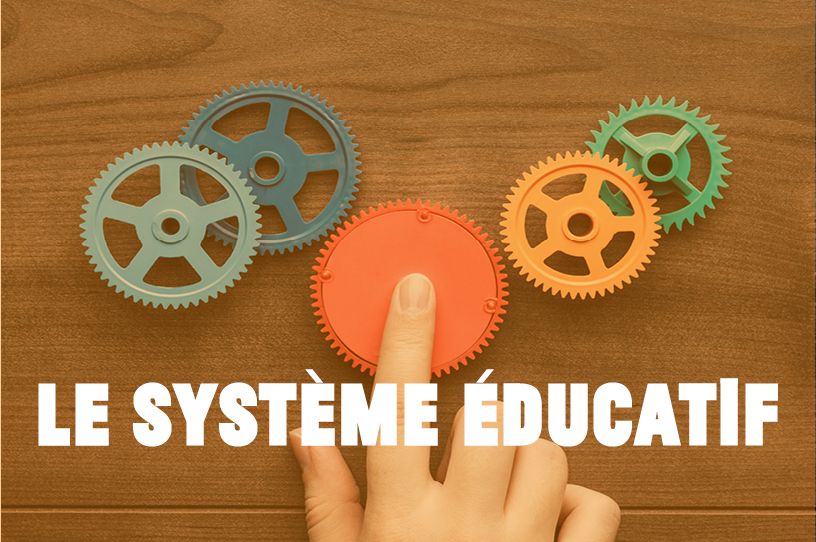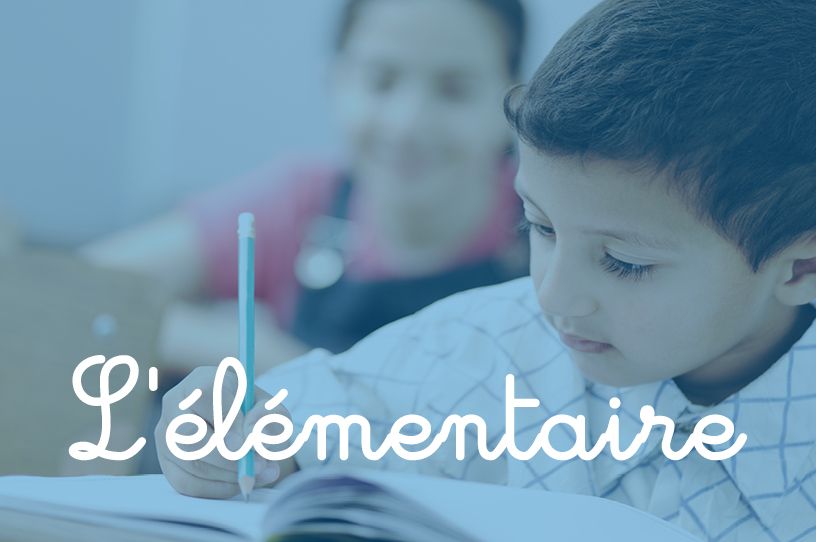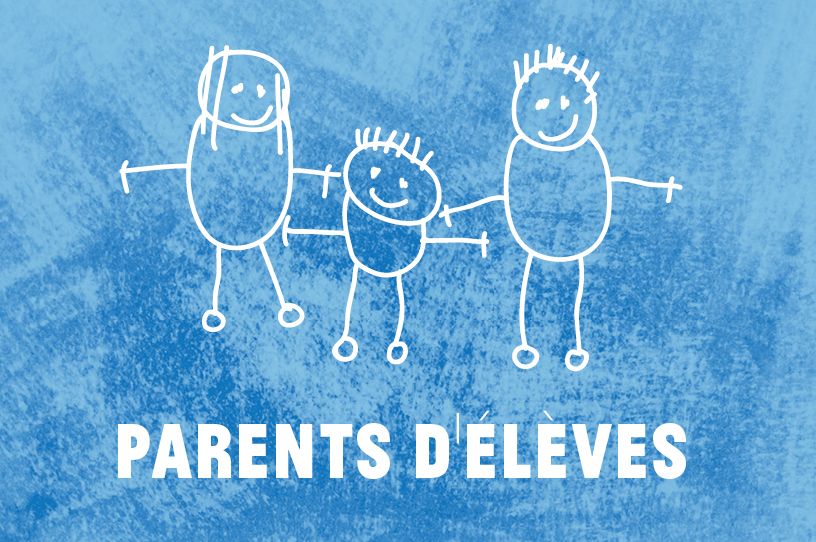Retraite
Mis à jour le 05.04.24
min de lecture
Après la création du corps de professeur des écoles et les réformes successives de 2003, 2010 et 2014, 2023 il est devenu difficile de se repérer dans les mécanismes de calcul d'une pension devenus très complexes...
– Les éléments de base : comment se calcule une retraite ?
– Informations complémentaires
– Nos retraites, d’hier à demain
– Devenir et être retraité·e
– Ressources
Retrouvez toutes ces questions dans notre site dédié nos-retraites.snuipp.fr