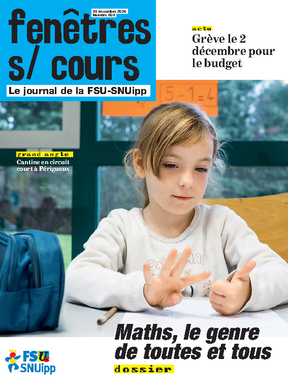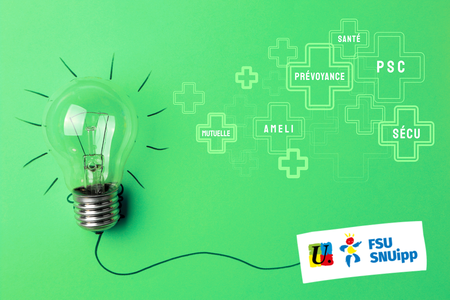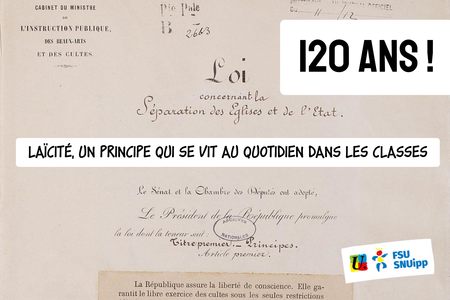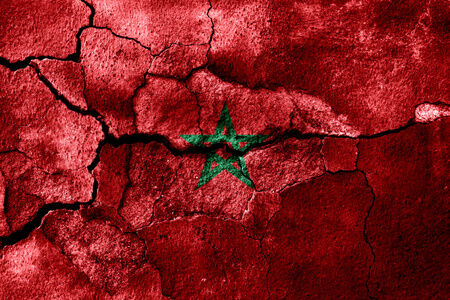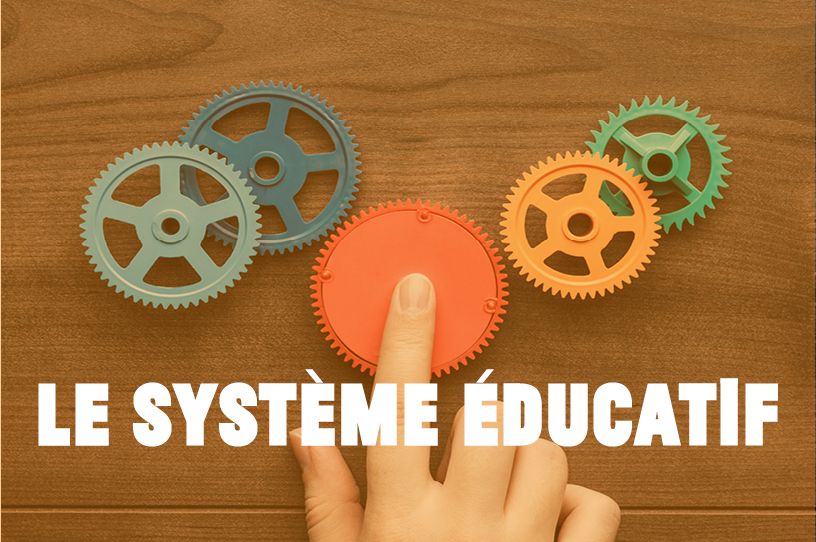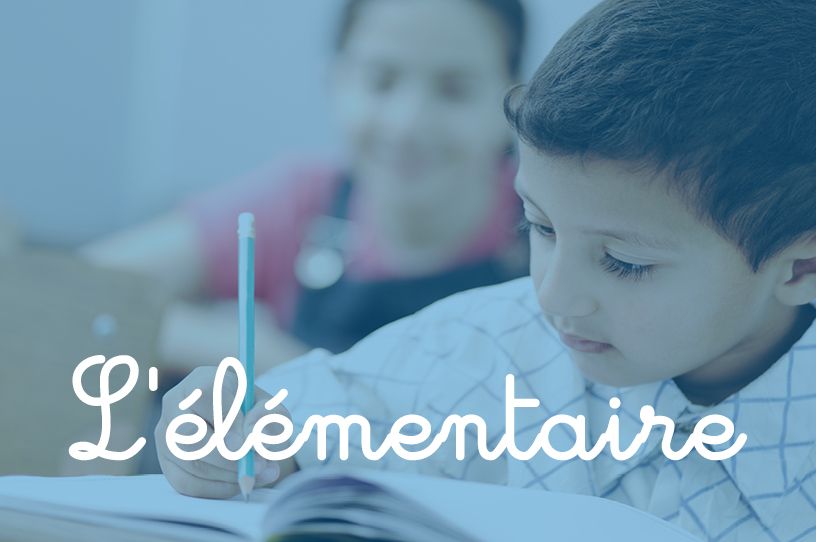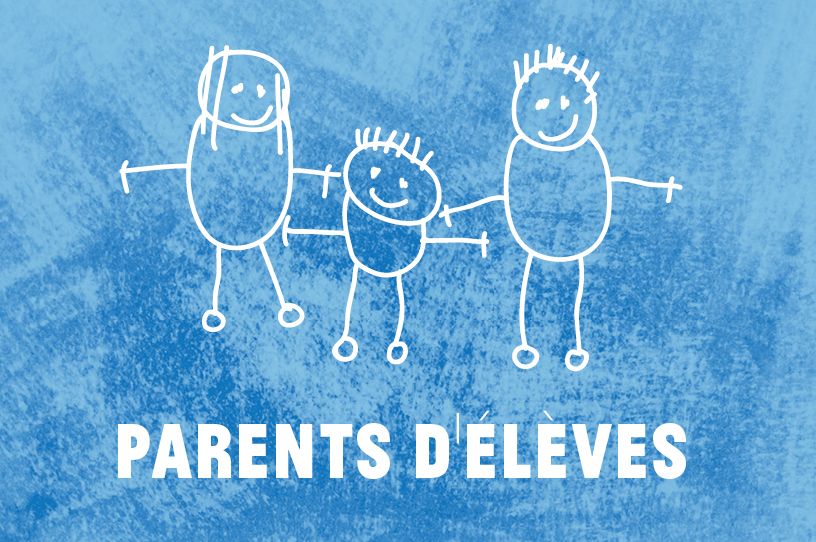Socle ou culture, choisir les deux
Mis à jour le 03.09.19
min de lecture
Des approches différentes du rôle de l'école dans la société
Derrière ces dénominations apparemment proches se cachent des approches radicalement différentes du rôle de l’école dans la société.
Pendant des décennies, le seul objectif de l’école française fut la réussite scolaire par la valorisation des enseignements académiques. Apparu avec la loi Fillon de 2005, le « socle commun des connaissances et des compétences » a introduit un « Smic culturel » comme le souligne Denis Paget de l’Institut de recherche de la FSU. L’objectif affiché était de correspondre aux compétences-clé européennes et dans les faits il entérinait une école à deux vitesses, où « tout le monde aurait le socle et certains seulement la statue », selon Philippe Meirieu pour qui « Tout savoir doit être enseigné comme culture ». En 2013, la loi pour la refondation de l’école, dite loi Peillon, part du constat de la persistance de la reproduction des inégalités sociales sur la réussite scolaire et ajoute la notion de culture au socle tout en conservant le principe d’une base permettant à l’ensemble des élèves d’acquérir « une culture commune, fondée sur les connaissances et compétences indispensables, qui leur permettra de s’épanouir personnellement, de développer leur sociabilité, de réussir la suite de leur parcours de formation, de s’insérer dans la société où ils vivront et de participer, comme citoyen, à son évolution ». S’il est bien sûr important d’apprendre à l’école le lire-écrire-compter, il est tout aussi essentiel d’y dispenser une culture commune qui permette de combler les inégalités, rompre avec la hiérarchie sociale des savoirs, diversifier les centres d’intérêt, créer du lien, éveiller la curiosité et les questionnements de tous les élèves.