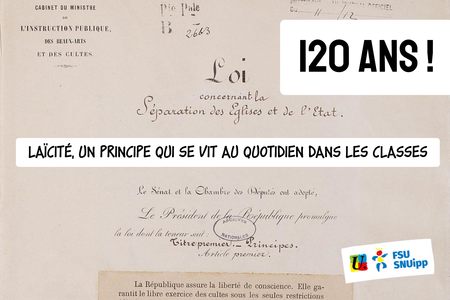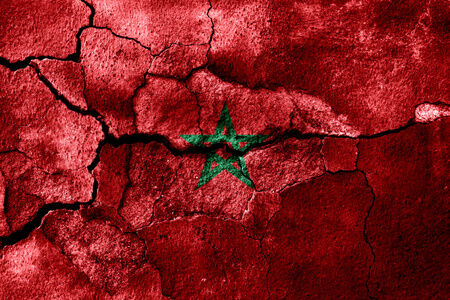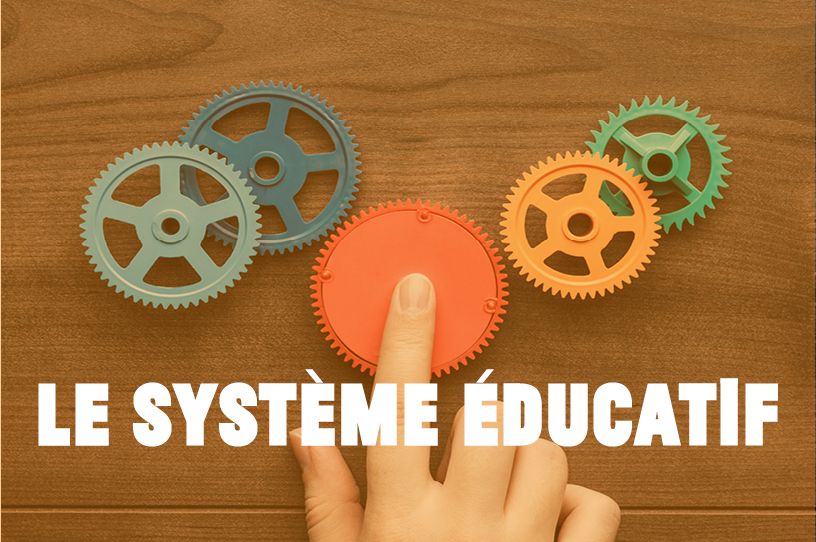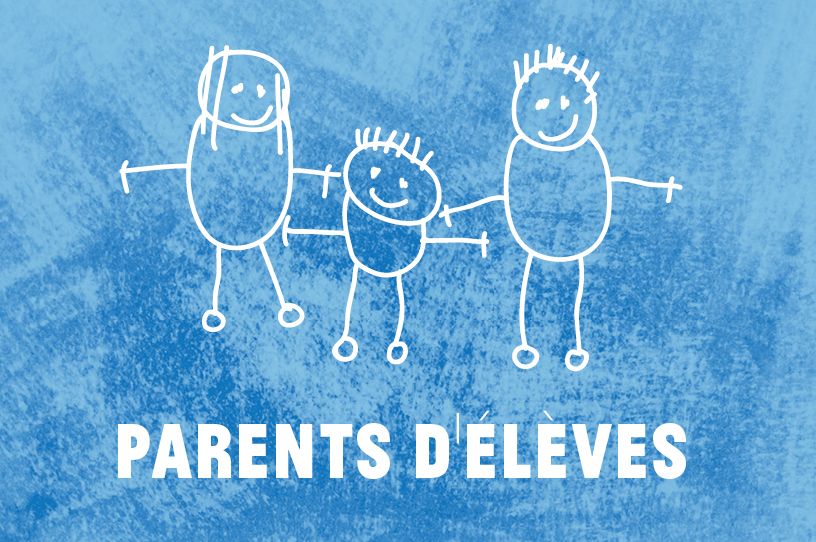Ce que l'école peut encore pour la démocratie...
Mis à jour le 17.11.20
min de lecture
Régulièrement présent aux Universités d’automne, Philippe Meirieu développe une analyse riche et complexe de notre système éducatif basée sur la pédagogie et la nécessaire émancipation de l’élève.
"Que l’entraide et la coopération entre élèves deviennent un principe fondateur de notre école publique.”

Philippe Meirieu a été successivement instituteur, professeur de français en collège et de philosophie en terminale, avant de prendre des responsabilités pédagogiques et administratives. Il a été directeur de l’Institut des sciences pratique de l’éducation et de la formation de l’Université LUMIERELyon2, directeur de l’INRP – Institut National de Recherche Pédagogique puis de juin 1998 à mai 2000, directeur de l’IUFM de Lyon. Il est aujourd’hui professeur des universités émérite en sciences de l’éducation.
Il vient de publier "Ce que l’école peut encore pour la démocratie, deux ou trois choses que je sais (peut-être) de l’éducation et de la pédagogie"
aux éditions Autrement. Dans ce nouvel essai personnel et toujours engagé, Philippe Meirieu raconte son histoire de la pédagogie. Des « hussards noirs » de la République aux « enfants sauvages », de Rousseau à Montessori, Freinet et tant d’autres, il livre une fresque passionnante qui revient sur les rencontres, les travaux et les engagements qui ont contribué à forger se convictions. En s’y décrivant à la fois comme élève et professeur, étudiant et chercheur, père de famille et citoyen engagé.
“Si j’avais à me définir et à trouver une unité entre toutes mes activités et tous mes engagements,
je dirais que je suis essentiellement un enseignant. Ce qui m’anime depuis toujours,
c’est la passion de transmettre et de faire comprendre.”
VOUS ÊTES, À LA FOIS ET DEPUIS LONGTEMPS, UN MILITANT PÉDAGOGIQUE ET UN CHERCHEUR UNIVERSITAIRE. EST-CE QUE CETTE SITUATION N’EST PAS TROP INCONFORTABLE ?
Si j’avais à me définir et à trouver une unité entre toutes mes activités et tous mes engagements, je dirais que je suis essentiellement un enseignant. Ce qui m’anime depuis toujours, c’est la passion de transmettre et de faire comprendre. J’ai exprimé cette passion comme professeur de philosophie et de lettres, mais aussi comme instituteur et enseignant à l’université en sciences de l’éducation. C’est la même passion qui m’a animé face à des groupes de décrocheurs ou des adultes de « bas niveau de qualification » et qui m’anime encore aujourd’hui quand j’ai la chance de faire de la formation avec des collègues. Et c’est justement dans cet acte d’enseigner que se nouent, de manière profondément solidaire, mon militantisme et mes travaux de recherche. Enseigner, en effet, c’est vouloir « partager les savoirs à l’infini », sans jamais se résigner à ce que quiconque soit exclu de ce partage… et, c’est là, dans cette conviction de l’éducabilité de toutes et de tous, que se trouve la source de mon militantisme. Mais enseigner, c’est aussi se heurter à la résistance de ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas apprendre au moment où vous le décrétez… et c’est là que se trouve la source de toute une série de recherches sur les conditions qui empêchent ou facilitent les apprentissages mais également sur ce qui se joue dans la relation pédagogique et permet d’en faire une authentique relation d’émancipation… C’est sur cette articulation que j’ai travaillé depuis toujours avec de nombreux collègues, tant à l’université que dans les classes, et c’est pourquoi je dis souvent, sans démagogie aucune, que tout enseignant peut être un « enseignant-chercheur ».
COMMENT DÉFINIRIEZ-VOUS, PRÉCISÉMENT, LA RELATION D’ÉMANCIPATION DONT VOUS PARLEZ ?
Pour qu’il y ait émancipation, il faut qu’il y ait d’abord « incorporation ». Albert Jacquard définissait la transmission comme un métabolisme : quand le lapin mange de la luzerne, cela ne fait pas du lapin « plus » de la luzerne… avec la luzerne, le lapin fait du lapin ! C’est comme le petit Yann ou la petite Sarah : il faut qu’ils fassent leurs les mathématiques, la grammaire et la géographie, qu’ils se les incorporent et que cela les fasse grandir, qu’ils puissent les utiliser pour penser et agir eux-mêmes, et pas seulement pour réussir des évaluations plus ou moins standardisées. Ensuite, pour qu’il y ait émancipation, il faut qu’il y ait « subversion ». Et la subversion n’est pas, évidemment, le refus buté, ni même le simple détachement à l’égard du « transmetteur », c’est le fait de s’approprier ce qui est transmis, non pas par simple obéissance ou respect du maître, mais parce qu’on l’a passé au crible d’une exigence intérieure de précision, de justesse et de vérité. La véritable émancipation suppose qu’en même temps que les savoirs, soit transmise l’exigence de mieux et plus savoir, l’exigence d’être plus exact, plus rigoureux, plus abouti dans tout ce que l’on fait… Si l’élève a toujours besoin de la présence de l’adulte à ses côtés pour exprimer de l’exigence à son égard, il reste dépendant, tributaire d’une situation où il est toujours infériorisé.
“Albert Jacquard définissait la transmission comme un métabolisme : quand le lapin mange de la luzerne,
cela ne fait pas du lapin plus de la luzerne… avec la luzerne, le lapin fait du lapin ”

“FAIRE INTÉRIORISER L’EXIGENCE”… OUI, MAIS COMMENT ? CELA NE SEMBLE PAS FACILE...
Des psychologues comme Wallon, Piaget et Vygotsky nous ouvrent, chacun à leur manière, des pistes pour cela. Piaget, par exemple, parle de la capacité de se « décentrer », c’est-à-dire de se placer à l’égard de soi-même du point de vue d’autrui et, par exemple, de s’interroger quand on parle sur l’intelligibilité de ce qu’on dit en se mettant à la place de celui qui écoute. Il faut, dit-il, « que chacun tienne ainsi à sa perspective propre, comme à la seule qu’il connaisse de l’intérieur, mais comprenne l’existence des autres perspectives ; que chacun comprenne surtout que la vérité, en toutes choses, ne se rencontre jamais toute faite, mais s’élabore péniblement, grâce à la coordination même de ces perspectives »… Or, cela ne va pas de soi et ne se met pas en place spontanément dans la classe. Pour comprendre comment avancer vers cela, on peut évoquer la manière dont Célestin Freinet proposait de faire travailler la « mise au point » (ou le « polissage ») des textes libres : l’élève qui a travaillé son texte vient l’écrire au tableau et le maître interroge ses camarades pour qu’ils suggèrent des améliorations en les justifiant le mieux possible. Mais les suggestions ne sont que des propositions et c’est à l’auteur du texte de les accepter ou de les refuser selon qu’elles améliorent son texte ou le trahissent. Il va donc falloir qu’il entende et examine « de l’intérieur », comme dit Piaget, les propositions des autres… et que, tout à la fois, il apprenne des autres et apprenne à se mettre à la place des autres. C’est ainsi qu’il intériorise l’exigence… et vous voyez que si l’on prend cela au sérieux, cela change complètement la fonction de ce que l’on appelle l’évaluation. Pour qu’une évaluation fasse progresser quelqu’un, il faut qu’il l’intériorise comme une autoévaluation et qu’on lui permette de voir qu’en tenant compte de celle-ci il peut progresser, et même devenir fier du résultat qu’il va obtenir…
C’EST POUR CELA QUE VOUS CRITIQUEZ LES ÉVALUATIONS NATIONALES ?
Oui, pour cela, pour le temps perdu et pour les dangers évidents de flicage des enseignants et de mise en concurrence de tout et de tous. L’évaluation éducative n’est pas faite pour savoir si l’on est meilleur que les autres, mais pour devenir meilleur que soi-même. Et puis, évaluer en classe s’inscrit dans une démarche pédagogique globale : on évalue d’autant mieux que l’on conçoit l’évaluation en lien avec les remédiations individuelles et collectives, qu’on implique les élèves dans l’exploitation des résultats de l’évaluation comme dans le suivi de leurs progrès… Après, si l’on veut que les enseignants puissent mesurer l’écart entre le niveau de leurs élèves et le niveau attendu au plan national, on peut mettre à leur disposition des outils pour cela qu’ils utiliseront librement sans faire remonter de résultats. Et, si l’on veut avoir une vision nationale du niveau des élèves, utilisons la méthode très fiable de l’échantillon...
“L’évaluation éducative n’est pas faite pour savoir si l’on est meilleur que les autres,
mais pour devenir meilleur que soi-même.”
QUAND VOUS PENSEZ À CES CINQUANTE DERNIÈRES ANNÉES, Y AT-IL EU, À VOS YEUX, DES RÉFORMES ESSENTIELLES QUI ONT FAIT AVANCER L’ÉCOLE ? ET CERTAINES RÉFORMES ONT-ELLES EU DES EFFETS CATASTROPHIQUES ?
Je ne suis pas un historien de l’institution, mais je pointerai un basculement positif et un basculement négatif. Le basculement le plus positif, à mes yeux, c’est la mise en place du « Plus de maîtres que de classes » : non pas simplement parce que cela a été corrélé à la création de postes, mais parce que c’est un vrai changement de paradigme aux effets déterminants. En adoptant ce principe, on rompt, en effet, complètement avec une « forme scolaire » dépassée et sclérosante : un enseignant solitaire face, toute la journée, à une classe censée être plus ou moins homogène. On ouvre la possibilité d’un travail d’équipe et de l’organisation en groupes de besoins, par exemple. On passe d’un modèle figé de juxtaposition de classes à un modèle dynamique dont la gestion est confiée à l’intelligence collective des enseignants. À cet égard, cette réforme est plus déterminante que la réforme des cycles, qui était, à mes yeux, pourtant, un progrès significatif mais qui est loin d’avoir tenu toutes ses promesses en raison, précisément, de l’absence d’un levier institutionnel comme « Plus de maîtres que de classes »… Quel gâchis d’avoir sacrifié cette avancée !
Quant au basculement négatif, il est, pour moi, dans le glissement progressif de la conception du rôle de l’enseignant. On est passé d’une conception relativement « ouverte » où l’enseignant était « nourri » de pédagogie (dans sa formation initiale et continue, mais aussi parce que les publications pédagogiques étaient beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus diffusées), à une conception beaucoup plus « fermée » où l’enseignant est bombardé de consignes, d’évaluations et de procédures standardisées. Le double parrainage affiché de Jean-Michel Blanquer – les évaluations internationales et les neurosciences – est à cet égard, très significatif : les évaluations internationales sont déclinées à l’infini avec l’immense danger de la réduction de l’éducation au seul quantifiable et au « teaching by the tests » ; quant aux neurosciences, qui représentent un éclairage parmi d’autres de l’activité éducative, à côté de la psychanalyse, de la sociologie, de l’histoire ou de la linguistique, elles sont utilisées comme outil indiscutable de prescriptions.
POURQUOI CELA EST-IL DANGEREUX ?
Parce que, même si l’on accepte tout ce que nous disent les neurosciences sur le fonctionnement du cerveau, elles ne peuvent nullement nous exonérer des interrogations sur les choix des contenus ou sur la manière de mobiliser les élèves. Enseigner nécessite, certes, d’avoir des connaissances scientifiques sur les apprentissages, mais enseigner, c’est aussi prendre des informations dans ce que l’on vit, faire des propositions pertinentes dans une situation donnée et réguler son activité en étant capable d’analyser ce qui se passe. Prenons un exemple : l’histoire de la pédagogie, mais aussi les recherches contemporaines, nous montrent que, pour engager des élèves sur des apprentissages il peut être utile de leur proposer un projet qui les mobilise et donne du sens aux savoirs… Mais ce projet peut être aspiré par une « logique productive », engager la classe dans une division du travail entre concepteurs, exécutants, chômeurs et gêneurs, et faire oublier les savoirs visés… D’où la nécessité de bien identifier et formaliser ce qui est attendu, découvert, appris et transférable… Mais la formalisation est toujours menacée par le formalisme, ce que Célestin Freinet nommait la scolastique et qui sélectionne, à son tour, ceux qui ont découvert en dehors de l’école « la saveur des savoirs », pour reprendre la belle formule de Jean-Pierre Astolfi… Alors, il n’y a pas d’autre solution pour l’enseignant que d’exercer son jugement et de déplacer le curseur vers plus de finalisation ou plus de formalisation en fonction de ce qui se passe sous ses yeux et qui n’est jamais identique d’une classe à l’autre, d’un moment à l’autre. Autant dire que l’enseignant est à la fois un concepteur et un décideur et qu’il faut le former et le considérer en tant que tel..
“Le basculement le plus positif, à mes yeux, c’est la mise en place du Plus de maîtres que de classes :
non pas simplement parce que cela a été corrélé à la création de postes,
mais parce que c’est un vrai changement de paradigme aux effets déterminants.”
POURQUOI N’ARRIVE-T-ON PAS À ENDIGUER LES INÉGALITÉS SCOLAIRES ?
Les inégalités scolaires renvoient, évidemment aux inégalités sociales et aux politiques éducatives au sens large. Dans un pays où les inégalités de richesse et de condition de vie se creusent, il ne faut pas s’étonner que nous peinions à endiguer les inégalités scolaires. Et c’est d’autant plus grave que nous sommes un des pays où le destin professionnel des individus est le plus déterminé par sa carrière scolaire : la formation continue ne profite guère qu’à ceux qui ont déjà bénéficié de la formation initiale… voilà un scandale dénoncé depuis longtemps et sur lequel nous ne progressons guère ! Et puis, sur un plan plus général, il faut quand même rappeler, comme le fait Thomas Piketty dans Capital et idéologie, que « les dépenses publiques en termes d’éducation, qui avaient connu une progression considérable au cours du XXe siècle […] ont cessé de s’accroître depuis les années 1980-1990 », alors que les besoins et les
ambitions éducatives affichées n’ont cessé de progresser. Reste bien sûr, que, même dans ce contexte – et, surtout peut-être dans ce contexte –, les pédagogues ne doivent pas baisser la garde et basculer dans le fatalisme. Plus que jamais, ils doivent militer pour « le droit à l’éducation de toutes et tous » et contre l’idéologie pernicieuse de « l’égalité des chances » qui ignore les difficultés réelles auxquelles sont confrontés nombre d’enfants. Nous devons être porteurs du postulat d’éducabilité et rappeler sans cesse son pouvoir authentiquement subversif.
ET, CONCRÈTEMENT, QUE PEUT LA PÉDAGOGIE CONTRE LES INÉGALITÉS ?
Il y a, à mes yeux, deux principes à ne pas perdre de vue pour construire une école porteuse d’égalité authentique. D’abord, le refus de toute sélection à l’implicite : une pédagogie qui pratique la complicité culturelle ou psychologique avec quelques élus, qui ne précise pas clairement ce qu’elle attend des élèves, qui ne s’interroge jamais sur la construction du rapport aux savoirs scolaires, ne peut pas prétendre lutter contre les inégalités. Mais il ne faudrait pas en conclure qu’il suffit d’être explicite pour faire réussir tous les élèves : le désir d’apprendre n’est pas spontané et on ne peut se contenter de le supposer ou de regretter son absence… Ce désir se construit dans des situations où l’enfant découvre que le plaisir de la recherche exigeante est plus grand que celui de la rétention dans des représentations approximatives, voire dans des slogans ou des théories fumeuses qui séduisent par leur caractère miraculeux…
“On est passé d’une conception relativement ouverte où l’enseignant était nourri de pédagogie,
à une conception beaucoup plus fermée où l’enseignant est bombardé de consignes,
d’évaluations et de procédures standardisées.”

BEAUCOUP DE LIVRES TITRENT SUR LA DÉMOCRATIE ACTUELLEMENT. QUEL EST LE RÔLE DE L’ÉCOLE DANS CE DOMAINE ?
Nous comprenons de plus en plus que la démocratie n’est jamais instituée une bonne fois pour toutes grâce à des dispositifs institutionnels, mais qu’elle doit en permanence se ressourcer en s’interrogeant sur elle-même, en construisant des débats solides et des démarches toujours plus ambitieuses de mobilisation citoyenne. C’est une véritable aspiration, je crois. Même si elle est mal formulée ou donne lieu à des manifestations maladroites… Or, faire exister la démocratie comme « dynamique politique » impose une formation des citoyens, et ce dès l’école, tout à la fois à la capacité de « penser par soi-même » et à celle de « fabriquer du commun », deux exigences pas si faciles à combiner. La première peut nous faire basculer dans la juxtaposition des individualismes, la seconde dans l’identification aveugle à un chef ou à une idéologie identitaire. Permettre à chacune et à chacun de se sentir accueilli et reconnu avec ses singularités dans un collectif, tout en les invitant à s’associer ensemble dans un projet commun et à coopérer, voilà le défi ! Et je crois précisément que la « pédagogie coopérative » peut aider à ce que nos enfants relèvent ce défi.
POUR VOUS, QUELLES SERAIENT LES MESURES D’URGENCE POUR L’ÉCOLE ?
Bien évidemment, elles concernent d’abord la gestion de l’actuelle pandémie : depuis le début, celle-ci est complètement erratique et se fait sans véritable concertation avec les enseignants. Ce n’est pas acceptable. Les enseignants ne demandent qu’à retourner en classe mais ils sont aussi des citoyens responsables qui tiennent à limiter la circulation du virus : il faut reprendre avec eux la gestion de cette crise sur de nouvelles bases. Et puis, plus globalement, l’école et les enseignants ont besoin de signes forts de reconnaissance, d’estime et de confiance authentique. En matière, par exemple, de gestion paritaire, de réflexion et d’organisation des évaluations, de concertation sur la direction d’école et les programmes et, bien sûr, de créations de postes. Il faut aussi, relancer d’urgence, la formation continue qui est aujourd’hui vraiment sinistrée, bien trop verticale et procédurale, quand il faudrait qu’elle accompagne les personnes à partir de leurs problèmes professionnels, en collaboration avec des chercheurs et sur la durée… Enfin, sur le plan proprement pédagogique, je souhaiterais que l’entraide et la coopération entre élèves soient considérées non plus comme des « suppléments d’âme » réservés à quelques innovateurs et aux « écoles alternatives », mais deviennent un principe fondateur de notre école publique. C’est un enjeu sociétal fondamental ! L’apprentissage de la solidarité n’est pas un choix parmi d’autres aujourd’hui, c’est ce qui donne sens à notre engagement éducatif et nous permet de ne pas désespérer de l’avenir.